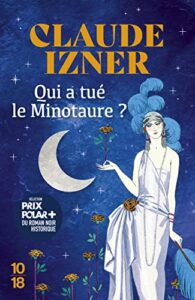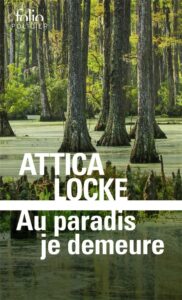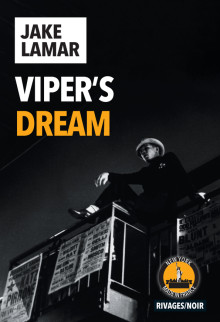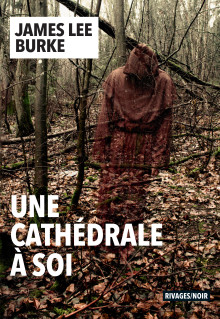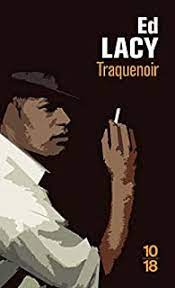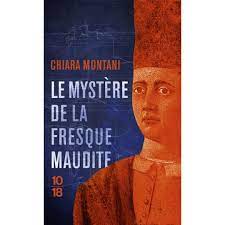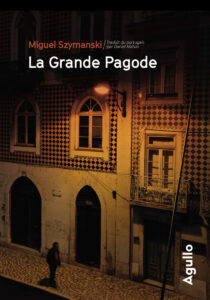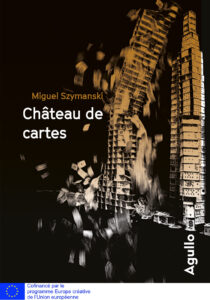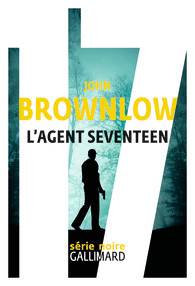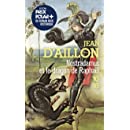Robicheaux au milieu de nul part, perdu dans le temps
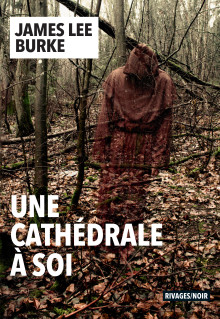 James Lee Burke aime les fantômes. Ils arrivent à être plus vrais que les vivant.e.s souvent proches des morts. En Louisiane, le vaudou reste présent et sait invoquer les morts-vivants. « Une cathédrale à soi » est une peinture quasi intemporelle – jamais n’apparaît une date pour se repérer dans le temps – du Bayou et des errances de Dave Robicheaux associé à Cletus, l’ami de toujours, réceptacle de toutes les violences, de toutes les violences face aux néo-nazis en train de peupler les États-Unis bien après la chasse aux sorcières, comme si le maccarthysme avait marqué de son empreinte terrifiante la terre comme les villes américaines.
James Lee Burke aime les fantômes. Ils arrivent à être plus vrais que les vivant.e.s souvent proches des morts. En Louisiane, le vaudou reste présent et sait invoquer les morts-vivants. « Une cathédrale à soi » est une peinture quasi intemporelle – jamais n’apparaît une date pour se repérer dans le temps – du Bayou et des errances de Dave Robicheaux associé à Cletus, l’ami de toujours, réceptacle de toutes les violences, de toutes les violences face aux néo-nazis en train de peupler les États-Unis bien après la chasse aux sorcières, comme si le maccarthysme avait marqué de son empreinte terrifiante la terre comme les villes américaines.
L’intrigue vient, comme souvent, de Shakespeare, de Roméo et Juliette qui prend l’apparence d’un couple de jeunes gens, Isolde Balangie et Johnny Shondell issues comme il se doit de deux familles de gangsters ennemis, qui ont fait fortune dans le trafic d’esclaves pour l’origine de leurs fortunes.
Un bourreau venant du fond des âges, 1600 en l’occurrence, veut se faire pardonner tous ses sévices – il était aux côtés de Mussolini – pour retrouver la paix de son cercueil et cesser d’encombrer les humains dans leur lutte pour le mal. Shondell semble être une incarnation de Trump ou l’inverse, on ne sait plus. Le fil se casse de temps en temps mais l’auteur sait d’un seul coup retrouver la grâce ou le malheur de son histoire.
Le brouillard du bayou sait cacher tous les trésors, toutes les turpitudes tout en dévoilant aux esprits fous les réalités enfouies au fin fond de nos cerveaux. « Les morts s’accrochent aux vivants » avait écrit Javier Cercas, James Lee Burke en fait une nouvelle démonstration.
Pourtant rien n’est jamais définitif surtout l’amour des jeunes gens mêmes s’ils savent chanter notre nostalgie, nos souvenirs.
N.B.
« Une cathédrale à soi », James Lee Burke, traduit par Christophe Mercier, Rivages/Noir
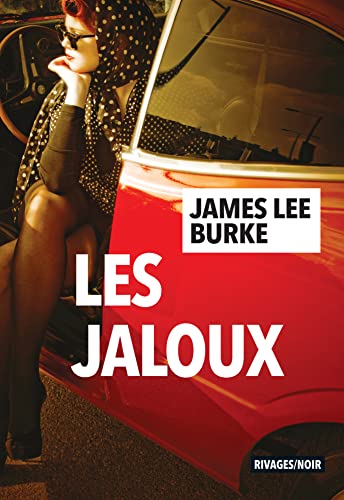 James Lee Burke fait une nouvelle fois la preuve qu’il est un des grands écrivains du Sud des États-Unis, un Faulkner contaminé par le polar pour faire éclater la réalité du monde. « Les jaloux » pose un adolescent, Aaron Holland Broussard, dans l’environnement du boom du pétrole – le film « Geant » avec James Dean et Rock Hudson le décrit aussi – qui a généré d’énormes fortunes, de la mafia toute puissante, la surexploitation des Mexicains et une police qui semble impuissante comme un racisme endémique. Les souvenirs des deux guerres sont encore présents pour le père du jeune homme qui noie sa mélancolie dans l’alcool alors que la mère se réfugie dans une dépression endémique. Continuer la lecture
James Lee Burke fait une nouvelle fois la preuve qu’il est un des grands écrivains du Sud des États-Unis, un Faulkner contaminé par le polar pour faire éclater la réalité du monde. « Les jaloux » pose un adolescent, Aaron Holland Broussard, dans l’environnement du boom du pétrole – le film « Geant » avec James Dean et Rock Hudson le décrit aussi – qui a généré d’énormes fortunes, de la mafia toute puissante, la surexploitation des Mexicains et une police qui semble impuissante comme un racisme endémique. Les souvenirs des deux guerres sont encore présents pour le père du jeune homme qui noie sa mélancolie dans l’alcool alors que la mère se réfugie dans une dépression endémique. Continuer la lecture