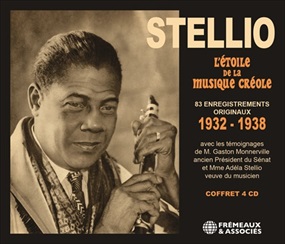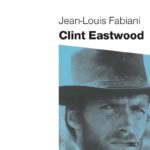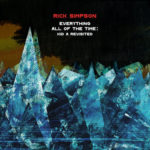Barclay et la révolution technologique de l’après seconde guerre mondiale.
Paris et la France découvrent, en même temps quasiment que les États-Unis par l’effet d’une grève des enregistrements de 1942 à 1944 – le « Petrillo ban » – la nouvelle révolution du jazz, le be-bop. Charles Delaunay qui reçoit au siège de Jazz Hot les premiers enregistrements de Dizzy Gillespie et de Charlie Parker sur le label « Guild » sait que le jazz d’aujourd’hui (1945) est là. La controverse sur le be-bop sera une des origines de la scission du Hot Club de France.
Il fallait trouver les moyens de diffuser cette révolution. Delaunay le fera via son label, « Swing » – puis Vogue pour éviter les procès avec Hugues Panassié – mais il ne sera pas le seul.
 Un pianiste de bar, Édouard Ruault bouleversé par le jazz, se lance dans la reprise d’enregistrements venant des États-Unis, sous le label « Blue Star ». Pas toujours de grande qualité , ces disques mettent à la disposition du public français les parutions américaines. A l’époque, les relations commerciales entre la France et les États-Unis sont encore marquées pat la guerre et, pour l’industrie phonographique par la grève. Comme disait Boris Vian pour signifier la qualité médiocre des reproductions et l’absence de concurrence « Mieux vaut Blue Star que jamais ».
Un pianiste de bar, Édouard Ruault bouleversé par le jazz, se lance dans la reprise d’enregistrements venant des États-Unis, sous le label « Blue Star ». Pas toujours de grande qualité , ces disques mettent à la disposition du public français les parutions américaines. A l’époque, les relations commerciales entre la France et les États-Unis sont encore marquées pat la guerre et, pour l’industrie phonographique par la grève. Comme disait Boris Vian pour signifier la qualité médiocre des reproductions et l’absence de concurrence « Mieux vaut Blue Star que jamais ».
Comme souvent en cette période – le film de Jacques Becker, « Rendez-vous de juillet », le montre bien – le Édouard livre les disquaire à vélo. Ce sera le début d’une aventure qui durera jusqu’à sa mort. Des débuts de la fortune à la ruine. Un itinéraire d’un enfant du siècle, du jazz au yéyé en passant par la grande chanson française. Édouard sera plus connu sous le nom d’Eddie Barclay.
J’en entends qui se récrie. Eddie Barclay, l’homme à femmes, en costume blanc, un verre de whisky à la main, un gros cigare à la bouche, rigolard, conviant toute la jet set à Saint-Trop ferait partie de notre patrimoine ? Que Nenni ! Pourtant… Continuer la lecture