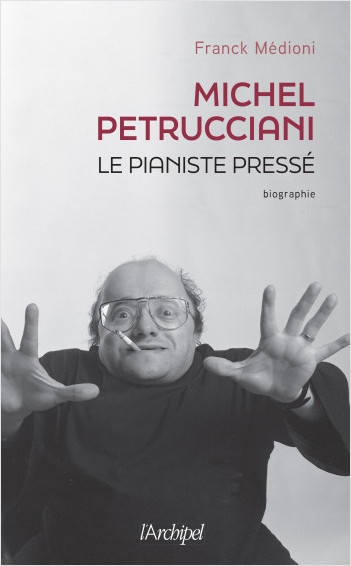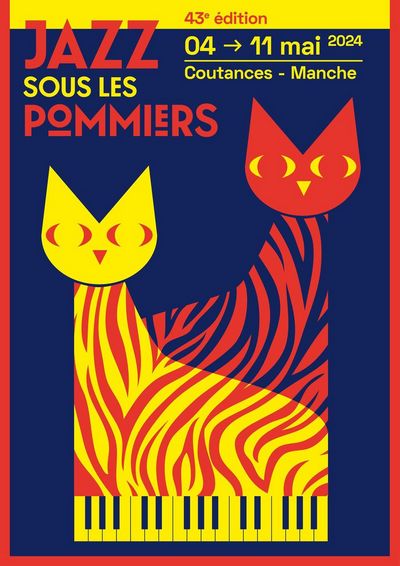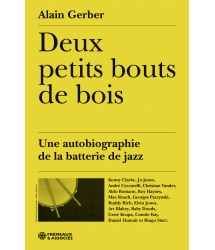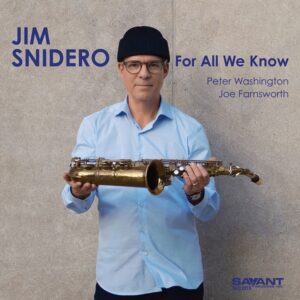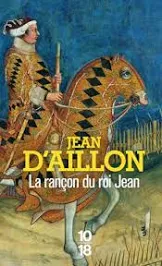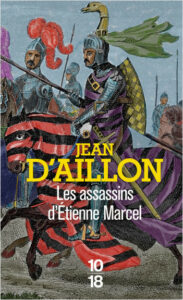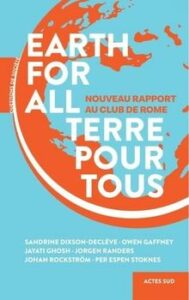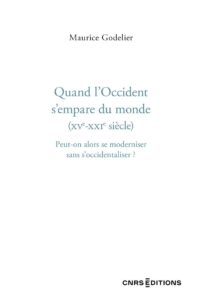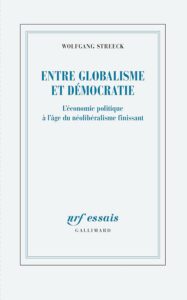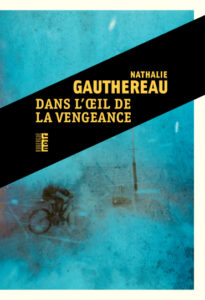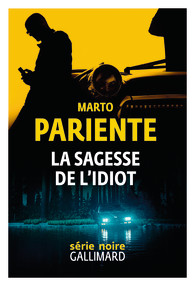Gênes, ville noire
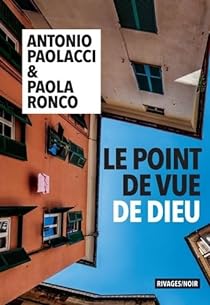 Antonio Paolacci & Paola Ronco ont décidé de faire de Gênes un personnage de polar pour conter les enquêtes de Paolo Nigra, tout autant Génois d’adoption que les deux auteurs. Le premier, « Nuages baroques », dévoilait une manière particulière de se servir des grands ancêtres du genre agrémentée de la visite des quartiers de Gênes sonnaient comme un vent nouveau. L’ironie de Nigra, homosexuel revendiqué, permettait de faire accepter des personnages par trop stéréotypés notamment ses acolytes de la police.
Antonio Paolacci & Paola Ronco ont décidé de faire de Gênes un personnage de polar pour conter les enquêtes de Paolo Nigra, tout autant Génois d’adoption que les deux auteurs. Le premier, « Nuages baroques », dévoilait une manière particulière de se servir des grands ancêtres du genre agrémentée de la visite des quartiers de Gênes sonnaient comme un vent nouveau. L’ironie de Nigra, homosexuel revendiqué, permettait de faire accepter des personnages par trop stéréotypés notamment ses acolytes de la police.
« Le point de vue de Dieu » tire les mêmes ficelles, avec une intrigue réduite au minimum. Pas besoin d’avoir lu Conan Doyle ou Agatha Christie pour savoir qui a tué. Le comment ne pose pas vraiment de problème même si le pourquoi un peu plus sophistiqué. La fin, digne d’un Hercule Poirot décadent, est décevante. La réunion de tous les protagonistes non seulement n’est pas réaliste mais est téléphonée.
L’amour de Nigra pour Rocco est compliqué et l’insistance sur ces difficultés – réelles – occupe une place disproportionnée. Par contre la visite du centre ville de Gênes est toujours un enchantement.
Les auteurs devraient changer leur référentiel pour aller vers d’autres influences, comme Hammett ou Chandler, parler de corruption, de mafia en donnant plus d’épaisseur aux comparses de Nigra.
Découvrir Gênes reste une bonne idée, même si ce club d’amateur de polars n’est pas vraiment fréquentable.
Nicolas Béniès
« « Le point de vue de Dieu », Antonio Paolacci & Paola Ronco, traduit par Sophie Bajard, Rivages/Noir
Morclose, Bretagne
« Vieux Kapiten », une nouvelle enquête/vengeance de Desmund Sasse, nous fait passer des villes bretonnes à l’Albanie pour décrire les circuits du trafic de drogue qui emmêlent des responsables politiques, des policiers et quelques « investisseurs » qui espèrent un retour rapide et important de leur mise de départ.
Danü Danquigny dans ce conte réel, fait de Sasse le porteur de toutes les colères face à la corruption généralisée. L’Albanie de Hodja porteuse, un temps, de promesses révolutionnaires s’est transformée en un champ de ruines de cultivateurs de drogue cornaqués par un caïd, un parrain. La pègre n’a pas de frontières et profite du libre échange international.
Pour alléger le tout feu tout flamme de ce roman, l’auteur propose des échappées poétiques. Une respiration nécessaire qui indique des voies de sorties et d’espérances pour imaginer un monde sorti de ce gris qui empêche toute illumination.
Une fin noire, sous la forme « le soleil ne brille pas ailleurs »… Une invite à changer la vie…
Nicolas Béniès
« Vieux Kapiten », Danü Danquigny, série noire/Gallimard
San Quentin
Le pénitencier de la côte Ouest des États-Unis est un enfer transformant les détenus en bêtes sauvages sans foi ni loi. Blancs et Noirs se font face. La barrière raciale s’impose comme une règle qu’il est impossible de transgresser. Art Pepper, saxophoniste alto, le raconte dans son autobiographie « Straight Life », traduite aux Éditions Parenthèses. Il l’a très mal vécu, d’autant que chaque « communauté » est dominée par les racistes. Du côté Blanc, la fraternité aryenne. Les métis, les chicanos essaient de se regrouper, rejetés qu’ils sont des deux « camps ».
Edward Bunker raconte la vie à San Quentin dans ce roman paru en 1977 aux Etats-Unis sous le titre « Animal Factory », une usine de déshumanisation si on force un peu la traduction, traduit en français – un tour de force – par « La bête contre les murs ». Un ouvrage de la collection « Les iconiques de François Guérif », rééditions de livres épuisés. Une histoire d’amitié filiale comme seules ces concentrations de barbaries savent les susciter. Une histoire qui rejoint beaucoup de celles racontées par ces enfermés. En 1974, libéré, Art Pepper enregistrera « The Trip », qu’il faut écouter en même temps que la lecture de ce livre.
Nicolas Béniès
« La bête contre les murs », Edward Bunker, traduit par Freddy Michalski, Rivages/Noir