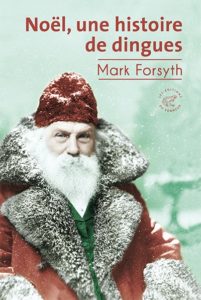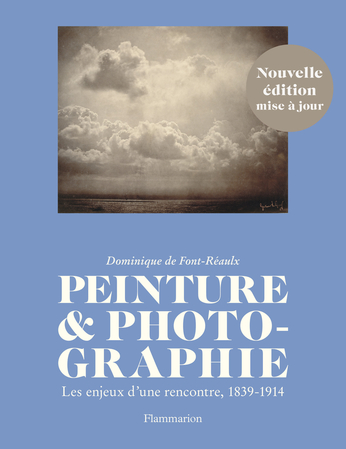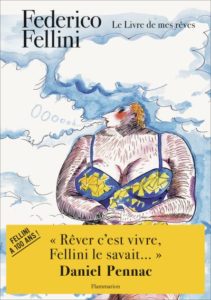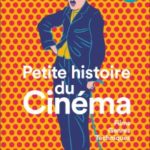Au plus près de l’émotion
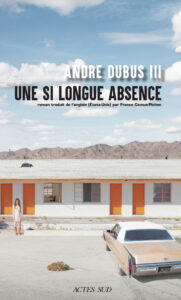 « Une si longue absence » est un curieux roman. Au sens strict, mis à part le crime de départ, il ne se passe rien à proprement parler. Mais Andre Dubus III arrive à tenir le lecteur en haleine avec des petits riens, un homme atteint d’un cancer, Daniel Ahern, voudrait dire – c’est le nœud du problème – à sa fille, Susan, qu’il l’aime simplement et… il ne peut pas. La mère de son épouse ne lui pardonne pas, une manière de remplir sa vie, les souvenirs prenant le pas sur la mémoire pour que chacune s’enferme dans une tour d’ivoire empêchant de prendre en compte l’autre et son amour éperdu.
« Une si longue absence » est un curieux roman. Au sens strict, mis à part le crime de départ, il ne se passe rien à proprement parler. Mais Andre Dubus III arrive à tenir le lecteur en haleine avec des petits riens, un homme atteint d’un cancer, Daniel Ahern, voudrait dire – c’est le nœud du problème – à sa fille, Susan, qu’il l’aime simplement et… il ne peut pas. La mère de son épouse ne lui pardonne pas, une manière de remplir sa vie, les souvenirs prenant le pas sur la mémoire pour que chacune s’enferme dans une tour d’ivoire empêchant de prendre en compte l’autre et son amour éperdu.
Un grand roman qui parle aussi des États-Unis d’aujourd’hui et de leurs déchirements.
N.B.
« Une si longue absence », Andre Dubus III, traduit par France Camus-Pichon, Actes Sud
Un poème épique,
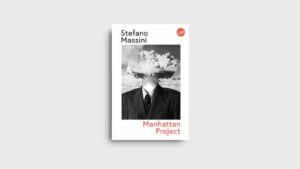 « Manhattan project », avec chœurs et récitants. Stefano Massini utilise l’art antique du chant pour mettre en scène les jeunes et brillants physiciens autour de Robert Oppenheimer, en 1938, qui étudient la mise au point d’une bombe atomique. Les doutes, les avancées se mêlent dans l’avancée des recherches et dans le poème lui-même capable de souligner toutes les dimensions d’un groupe secret forcément et replié sur lui-même, submergé par les découvertes et la compétition avec l’Allemagne nazie, sans le recul nécessaire pour apprécier la dimension barbare de cette arme ultime.
« Manhattan project », avec chœurs et récitants. Stefano Massini utilise l’art antique du chant pour mettre en scène les jeunes et brillants physiciens autour de Robert Oppenheimer, en 1938, qui étudient la mise au point d’une bombe atomique. Les doutes, les avancées se mêlent dans l’avancée des recherches et dans le poème lui-même capable de souligner toutes les dimensions d’un groupe secret forcément et replié sur lui-même, submergé par les découvertes et la compétition avec l’Allemagne nazie, sans le recul nécessaire pour apprécier la dimension barbare de cette arme ultime.
N.B.
« Manhattan project », Stefano Massini, traduit par Nathalie Bauer, Globe éditions
L’art du feuilleton
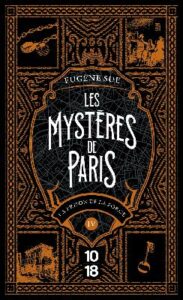 « Les mystères de Paris », une réédition en 4 tomes. L’art du feuilleton au 19e siècle, ancêtre des séries pour conter les bas quartiers de la capitale par l’intermédiaire d’un justifier, un aristocrate, une classe sociale déclassée face à des marginaux et en alliance avec certain.e.s pour nettoyer la société des malfaisants. Marx avait jugé cette fresque comme factice et dénuée de toute compréhension. Disons que Eugène Sue voulait divertir, y a réussi et est devenu riche. Les lire ces mystères qui en ont beaucoup perdus comme une borne dans notre histoire littéraire.
« Les mystères de Paris », une réédition en 4 tomes. L’art du feuilleton au 19e siècle, ancêtre des séries pour conter les bas quartiers de la capitale par l’intermédiaire d’un justifier, un aristocrate, une classe sociale déclassée face à des marginaux et en alliance avec certain.e.s pour nettoyer la société des malfaisants. Marx avait jugé cette fresque comme factice et dénuée de toute compréhension. Disons que Eugène Sue voulait divertir, y a réussi et est devenu riche. Les lire ces mystères qui en ont beaucoup perdus comme une borne dans notre histoire littéraire.
N.B.
« Les mystères de Paris », 4 tomes, 10/18
Un poème en prose et un conte afghan
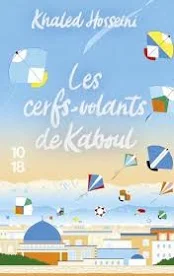 « Les cerfs-volants de Kaboul » se veut découverte de l’Afghanistan. Khaled Hosseini, qui vit aux Etats-Unis, présente son pays dans les années 1970, puis l’exil aux États-Unis. Les difficultés du père – Baba dans la langue de l’auteur – à s’intégrer dans cette société dont il ne comprend pas les codes et à peine la langue, est une description qui sonne juste des sentiments de tous les déplacé.e.s. Le cerf-volant représente l’image de liberté, de l’enfance, de l’amitié mais aussi d’une liberté perdue qui se symbolise dans l’ami perdu du narrateur. Le retour aux pays sous le joug des talibans est l’autre intérêt de ce roman quasi autobiographique, qui fait aussi la part belle aux contes de l’enfance.
« Les cerfs-volants de Kaboul » se veut découverte de l’Afghanistan. Khaled Hosseini, qui vit aux Etats-Unis, présente son pays dans les années 1970, puis l’exil aux États-Unis. Les difficultés du père – Baba dans la langue de l’auteur – à s’intégrer dans cette société dont il ne comprend pas les codes et à peine la langue, est une description qui sonne juste des sentiments de tous les déplacé.e.s. Le cerf-volant représente l’image de liberté, de l’enfance, de l’amitié mais aussi d’une liberté perdue qui se symbolise dans l’ami perdu du narrateur. Le retour aux pays sous le joug des talibans est l’autre intérêt de ce roman quasi autobiographique, qui fait aussi la part belle aux contes de l’enfance.
N.B.
« Les cerfs-volants de Kaboul », Khaled Hosseini, 10/18
Dans la tête de l’Autre
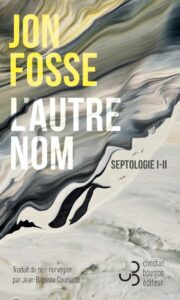 « L’Autre Nom » est un miroir déformé de deux trajectoires possibles. John Fosse, norvégien et prix Nobel de littérature 2023, au style d’écriture proche de James Joyce, pénètre dans l’univers de deux peintres au nom semblable, Asle. L’un vit en reclus, l’autre a les honneurs du public. Deux existences interchangeables. Pourquoi l’un a réussi et l’autre pas, question éternellement posée qui n’a que de lointains rapports avec le talent – une notion difficile à définir. Le Asle qui a réussi se met dans la tête d’aider son Autre lui-même. L’auteur, à l’instar d’un Claude Simon, nous balade dans les mémoires du – des ? – peintre. Il faut découvrir cet auteur étrange, pas encore très connu en France
« L’Autre Nom » est un miroir déformé de deux trajectoires possibles. John Fosse, norvégien et prix Nobel de littérature 2023, au style d’écriture proche de James Joyce, pénètre dans l’univers de deux peintres au nom semblable, Asle. L’un vit en reclus, l’autre a les honneurs du public. Deux existences interchangeables. Pourquoi l’un a réussi et l’autre pas, question éternellement posée qui n’a que de lointains rapports avec le talent – une notion difficile à définir. Le Asle qui a réussi se met dans la tête d’aider son Autre lui-même. L’auteur, à l’instar d’un Claude Simon, nous balade dans les mémoires du – des ? – peintre. Il faut découvrir cet auteur étrange, pas encore très connu en France
N.B.
« L’Autre Nom », Jon Fosse, traduit par Jean-Baptiste Coursaud, Christian Bourgois Éditions.
Une découverte à ne pas rater
 « Ravages » de Violette Leduc. Gallimard avait déjà publié ce récit – roman ne convient, autobiographie pas totalement – largement amputé de sa première partie désorganisant l’ensemble, comme le soulignent les deux préfacières Camille Froidevaux-Metterie et Mathilde Forget. « Édition augmentée » dit le sous titre, manière de dire que la censure de l’époque a détruit la construction de cde texte. Violette Leduc sait trouver les mots pour faire ressentir l’amour, ici lesbien, et décrire un viol. Se dégage de cette nouvelle version une force littéraire qui provoque un torrent d’émotion. L’équipe réunie autour de Margot Gallimard a réalisé un travail vital pour rendre vivante l’art de Violette Leduc.
« Ravages » de Violette Leduc. Gallimard avait déjà publié ce récit – roman ne convient, autobiographie pas totalement – largement amputé de sa première partie désorganisant l’ensemble, comme le soulignent les deux préfacières Camille Froidevaux-Metterie et Mathilde Forget. « Édition augmentée » dit le sous titre, manière de dire que la censure de l’époque a détruit la construction de cde texte. Violette Leduc sait trouver les mots pour faire ressentir l’amour, ici lesbien, et décrire un viol. Se dégage de cette nouvelle version une force littéraire qui provoque un torrent d’émotion. L’équipe réunie autour de Margot Gallimard a réalisé un travail vital pour rendre vivante l’art de Violette Leduc.
N.B.
« Ravages », Violette Leduc, Hors Série l’Imaginaire/Gallimard.
Science… et médecine légale
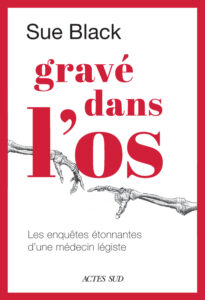 « Gravé dans l’os », source de polars. Sue Black est une anatomiste et anthropologue médico-légale, une médecin légiste pour parler autrement, qui nous fait visiter les cas qu’elle a eus à traiter. Elle passe en revue les différents parties du corps pour expliquer comment décrypter les lésions sur les os. Le squelette est un révélateur. A chaque fois, l’enquête pourrait fait l’objet d’une intrigue.
« Gravé dans l’os », source de polars. Sue Black est une anatomiste et anthropologue médico-légale, une médecin légiste pour parler autrement, qui nous fait visiter les cas qu’elle a eus à traiter. Elle passe en revue les différents parties du corps pour expliquer comment décrypter les lésions sur les os. Le squelette est un révélateur. A chaque fois, l’enquête pourrait fait l’objet d’une intrigue.
N.B.
« Gravé dans l’os. Les enquêtes étonnantes d’une médecin légistes », Sue Black, traduit par Lucie Modde, Actes Sud
Science… et BD
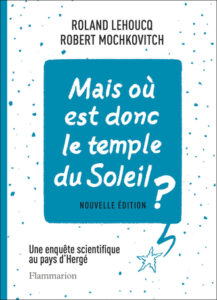 « Mais où est donc le temple du Soleil ? » et Hergé ? Roland Lehoucq et Robert Mochkovitch, deux astrophysiciens, étudient les références scientifiques de Hergé dans toutes les aventures de Tintin. Apparaît que Hergé s’appuie sur les théories de son temps, sans trop inventer. Les auteurs, sur la base de cette appréciation, développent les avancées actuelles. De quoi réaliser, de manière ludique, un traité sans trop le dire. Un beau cadeau pour les grands qui, sans doute, gardent un souvenir ému de Tintin, Milou et, bien sur, le capitaine Haddock.
« Mais où est donc le temple du Soleil ? » et Hergé ? Roland Lehoucq et Robert Mochkovitch, deux astrophysiciens, étudient les références scientifiques de Hergé dans toutes les aventures de Tintin. Apparaît que Hergé s’appuie sur les théories de son temps, sans trop inventer. Les auteurs, sur la base de cette appréciation, développent les avancées actuelles. De quoi réaliser, de manière ludique, un traité sans trop le dire. Un beau cadeau pour les grands qui, sans doute, gardent un souvenir ému de Tintin, Milou et, bien sur, le capitaine Haddock.
N.B.
« Mais où est donc le temple du Soleil ? Une enquête scientifique au pays d’Hergé », Roland Lehoucq, Robert Mochkovitch, Flammarion
Les réalisatrices
 « Moteur ! Elles tournent », le féminisme en action. Un coffret qui réunit trois réalisatrices en deux films et une autobiographie. Agnès Varda, « Cléo de 5 à 7 » – Corinne Marchand inoubliable comme le voulait la réalisatrice -, Chantal Ackerman, « Ma mère rit » – pour que sa fille pleure – et Alice Guy, longtemps oubliée qui fait de « La fée cinéma » la réhabilitation nécessaire d’une pionnière essentielle de cet art du 20e siècle. Plus que les frères Lumière, elle est celle qui permet au cinéma d’advenir. Comme dans les autres arts, les femmes ont longtemps été oubliées, ensevelies sous le poids des mâles. Redonner vie à Alice Guy est vitale pour notre mémoire.
« Moteur ! Elles tournent », le féminisme en action. Un coffret qui réunit trois réalisatrices en deux films et une autobiographie. Agnès Varda, « Cléo de 5 à 7 » – Corinne Marchand inoubliable comme le voulait la réalisatrice -, Chantal Ackerman, « Ma mère rit » – pour que sa fille pleure – et Alice Guy, longtemps oubliée qui fait de « La fée cinéma » la réhabilitation nécessaire d’une pionnière essentielle de cet art du 20e siècle. Plus que les frères Lumière, elle est celle qui permet au cinéma d’advenir. Comme dans les autres arts, les femmes ont longtemps été oubliées, ensevelies sous le poids des mâles. Redonner vie à Alice Guy est vitale pour notre mémoire.
Chaque livre est précédé de deux – ou trois pour Alice Guy – préfacières qui mettent expliquent, mettent en lumière les préoccupations des réalisatrices. A chaque fois, elles permettent d’interroger le film en soulignant la prise de position féministe.
Essentiel.
N.B.
« Moteur ! Elles tournent », L’Imaginaire/Gallimard avec Télérama.