Le Royaume de France en 1360
 Les livres d’Histoire ont longtemps parlé de la « guerre de 100 ans », manière d’écrire a posteriori pour des guerres continuelles de formation des royaumes, de dessin des frontières et de la création d’États centralisés que seront les monarchies absolues. En 1360, la désorganisation est totale. Les luttes internes, les intrigues, les alliances se nouent et se dénouent à la vitesse des tempêtes. L’absence d’armées officielles ouvre grand les portes aux mercenaires qui, faute d’engagements, se livrent à des destructions organisées ou sauvages au détriment de l’ensemble des populations.
Les livres d’Histoire ont longtemps parlé de la « guerre de 100 ans », manière d’écrire a posteriori pour des guerres continuelles de formation des royaumes, de dessin des frontières et de la création d’États centralisés que seront les monarchies absolues. En 1360, la désorganisation est totale. Les luttes internes, les intrigues, les alliances se nouent et se dénouent à la vitesse des tempêtes. L’absence d’armées officielles ouvre grand les portes aux mercenaires qui, faute d’engagements, se livrent à des destructions organisées ou sauvages au détriment de l’ensemble des populations.
Les réactions des bourgeois sont à la hauteur des craintes. Le futur « tiers-état » s’organise, à Paris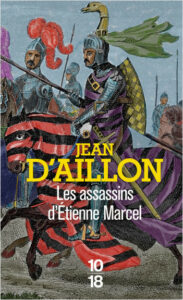 notamment sous la houlette de Etienne Marcel – il est resté sous forme de statue. Jean d’Aillon prenant prétexte de « La rançon du roi Jean », raconte le voyage périlleux d’une escouade de Milanais et de Florentins, sous la conduite de Pietro da Sangallo, ancien mercenaire et du poète Pétrarque, de Milan à Paris, au Louvre sous les auspices du Dauphin Charles. Pour l’Histoire, Jean le Bon a été fait prisonnier du Roi d’Angleterre à la bataille de Poitiers. Les lettres de change existent déjà mais une partie de la rançon doit être payée en monnaie sonnante et trébuchante.
notamment sous la houlette de Etienne Marcel – il est resté sous forme de statue. Jean d’Aillon prenant prétexte de « La rançon du roi Jean », raconte le voyage périlleux d’une escouade de Milanais et de Florentins, sous la conduite de Pietro da Sangallo, ancien mercenaire et du poète Pétrarque, de Milan à Paris, au Louvre sous les auspices du Dauphin Charles. Pour l’Histoire, Jean le Bon a été fait prisonnier du Roi d’Angleterre à la bataille de Poitiers. Les lettres de change existent déjà mais une partie de la rançon doit être payée en monnaie sonnante et trébuchante.
Le récit, un peu fastidieux, donne à voir l’état des campagnes.
La suite, « Les assassins d’Etienne Marcel », dessine les rapports des forces à Paris, sous la Régence du futur Charles V, des échevins majoritaires au Parlement, le Roi, la noblesse qui se déchire entre les différents suzerains. L’image de Jean le Bon est celle d’un homme coléreux capable de tuer ses pires amis et laisser ses ennemis développés leurs intrigues tandis que le dauphin apparaît plus pondéré, plus intelligent, mieux entouré. Se développe une véritable intrigue plus ou moins fondée historiquement mais qui entraîne le lecteur. Pietro sa Sangallo se transforme en détective.
Au-delà des longueurs, le tableau de l’état du Royaume de France en 1360 est une vraie leçon d’Histoire.
Nicolas Béniès
« La rançon du roi Jean » et « Les assassins d’Etienne Marcel », Jean d’Aillon, 10/18
Byzance en l’an 326 de notre ère
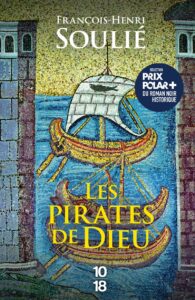 L’empereur Constantin pour des raisons politiques qui ne seront qu’effleurer organise une révolution difficile : imposer le christianisme face aux Dieux d’une Olympe en perdition pour unifier l’Empire. Il fait face à des intrigues et sa réponse est plus souvent très éloignée de la charité chrétienne, une leçon pour les dirigeants à venir.
L’empereur Constantin pour des raisons politiques qui ne seront qu’effleurer organise une révolution difficile : imposer le christianisme face aux Dieux d’une Olympe en perdition pour unifier l’Empire. Il fait face à des intrigues et sa réponse est plus souvent très éloignée de la charité chrétienne, une leçon pour les dirigeants à venir.
François-Henri Soulié, à travers le destin des deux adolescents liés par l’amour, raconte une intrigue visant à détrôner Constantin qui part de Jérusalem. Ce périple permet de déterminer la place fondamentale des esclaves – soit des prisonniers de guerre, soit des personnes endettées – dans le cursus de la production de richesses. Il donne aussi les raisons qui conduisent à la piraterie simplement pour survivre. « Les pirates de Dieu », titre étrange s’il en fut sinon à croire que les deux adolescents tiennent du Messie en ne formant qu’un seul corps. Une saga que l’on suit avec plaisir sans trop se soucier de la vérité historique que l’auteur revendique, dans une note de fin, en partie.
N.B.
« Les pirates de Dieu », François-Henri Soulié, 10/18
Un polar atemporel
 L’action pourrait se passer dans n’importe quel pays anglo-saxon, peut-être ailleurs n’étaient les procédures judiciaires différentes. Le contexte, politique, économique, social n’est pas nécessaire pour ce drame familial qui se joue quasiment à guichets fermés. John Wainwright est un spécialiste de ces intrigues intimes comme dans son roman le plus connu « A table », devenue « Garde à vue » pour le film adaptée par Claude Miller.
L’action pourrait se passer dans n’importe quel pays anglo-saxon, peut-être ailleurs n’étaient les procédures judiciaires différentes. Le contexte, politique, économique, social n’est pas nécessaire pour ce drame familial qui se joue quasiment à guichets fermés. John Wainwright est un spécialiste de ces intrigues intimes comme dans son roman le plus connu « A table », devenue « Garde à vue » pour le film adaptée par Claude Miller.
La famille d’un comptable apparemment sans histoire cherche à comprendre les raisons de sa condamnation pour meurtre sans qu’il ne fasse appel au grand dam de son avocat qui croit, à juste raison, à son innocence. S’ensuit une galerie de portraits. De son épouse dont on ne distingue pas les raisons de son mariage, de ses enfants, de son amoureuse cachée qui mène véritablement l’enquête, de sa fille et, finalement de ce comptable victime et bourreau, coupable malgré tout. « Les trois meurtres de William Drevert » s’expliqueront par l’absence de choix clairs de cet homme jamais présent mais qui se dessine au fur et à mesure, en creux, dans le relief contrasté de ses familles.
Très bien mené même si le style, la description de l’environnement apparaissent un peu surannés, comme des photos un peu vieillies, le lecteur se laisse prendre. La fin, un peu attendue, révèle des lâchetés quotidiennes qui peuvent provoquer des drames.
N.B.
« Les trois meurtres de William Drevert », John Wainwright, traduit par Clément Baude, 10/18
