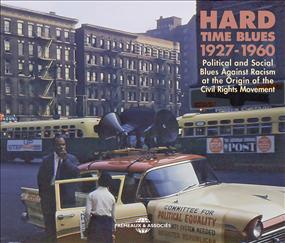Les Noirs, les bleus et les Blancs.
Quelle place occupe le blues – il faudrait utiliser le pluriel – dans l’histoire de la communauté africaine-américaine ? Quelles fonctions a-t-il joué ? Robert Springer, poursuivant ses analyses sociologiques commencées avec Le blues authentique (1985, Filipacchi) se penche sur Les fonctions sociales du blues, aux éditions Parenthèses dans la collection Eupalinos. Il part des fonctions les plus évidentes, les plus visibles – la mémoire, l’éducation, l’esclavage – pour arriver aux essentielles et cachées. La synthèse s’effectue par la fonction unificatrice de la communauté que le bluesman suscite simplement en racontant ses histoires tirées de sa propre vie. Elles donnent l’impression d’être individuelles. De parler apparemment des relations hommes/femmes. En fait par cet artifice, il met en scène les relations Blancs/Noirs. Sans sous estimer le «machisme » des mondes du blues, une réalité par trop présente. Comme le disait Zora Neale Hurston dont l’autobiographie, Des pas dans la poussière (Editions de l’Aube)1 vient de paraître en français, la femme noire est la «mule » de l’homme noir… Zora utilise le «double entendre » du blues, et la même forme, celle des histoires individuelles, la sienne, pour raconter l’oppression des femmes et la réalité sociale des Etats-Unis.
Ce monde du blues tend à s’estomper, à disparaître. L’intégration est apparemment réalisé. Les ghettos sont plus diffus. Le blues, folklore des populations africaines-américaines, ne correspond plus à des habitants des Inner City victimes du chômage, de la drogue et connaissant une distanciation par rapport à leurs racines africaines, à leur passé. Ils n’ont ni passé, ni avenir. Le bluesman avait beaucoup de points communs avec le griot africain, et Springer n’est ni le seul ni le premier à insister sur cet aspect, et le «double entendre » – comme disent les Américains – comme l’ironie sont des composantes fondamentales de ces poésies, qui lui donnent leur force tout en dissimulant leur message sous le divertissement, une autre fonction du blues.2
Tous ces éléments se retrouvent dans le «roman » – le «récit », le blues tout simplement – de Walter Mosley, La musique du diable (réédité dans la collection Points, au Seuil). Le titre américain RL Dream fait référence au nom véritable de Robert Johnson, le premier unificateur des blues qui, en 1936 et 37 a enregistré l’équivalent d’un double CD de ses compositions, devenues des «classiques ». Tout le monde a joué « Dust my Broom » ou « Sweet Home Chicago »3… La traduction française est intelligente. Devil’s music est l’appellation des ligues bien pensantes pour cette musique sexuée, libre et poussant au rire collectif contre l’oppression. Histoire de rencontres, comme souvent dans les blues, entre un homme noir, et une femme blanche subissant l’oppression des hommes. L’homme est vieux, malade. Il a terminé sa vie et veut témoigner d’une époque, d’une culture, celle du blues. Ils viennent du Sud et vivent à New York. Soupspoon – référence à la cuillère du diable vraisemblablement – fait l’amour avec une jeune femme démontrant la force renouvelée du blues et ses diableries. Mosley donne l’impression d’avoir lu le poème autobiographique de JJ Phillips qui dans Mojo Hand 4– intraduisible, ce titre fait référence au vaudou dont le blues se rapproche – fait part de son expérience, de sa rencontre à sa sortie de prison avec le bluesman Lightnin’ Hopkins, un des grands magiciens/poète de cette musique-art-de-vivre. Une manière de dire aux jeunes générations de se souvenir du passé, celui de l’oppression comme de la révolte. Au fur et à mesure que l’action ne progresse pas, cette époque semble dépassée.
C’est sans doute la raison pour laquelle ses «polars » se situent dans le passé, et à Watts le ghetto noir de Los Angeles. Dans Un petit chien jaune5, Easy Rawlins – son «détective privé » qui ne l’est officiellement pas, encore un coup du blues – mène une enquête peu claire aux débuts des années 60 se terminant par l’annonce de l’assassinat de Kennedy. Une autre façon de faire de l’Histoire à travers ces histoires. On y prend plaisir, de par l’écriture et les sous-entendus musicaux et tout simplement par l’histoire racontée.
Ces livres montrent que le blues à un passé et un présent mais pas forcément d’avenir. Il n’est plus la référence de toute une communauté qui voit ses racines et sa mémoire s’évanouir. Oublier l’esclavage est un non-sens. C’est le message de Tony Morrison.6 Le blues se répète, faute de possibles, faute de futur. Il devient un véhicule pour les jeunes blancs qui s’en servent pour exprimer leur révolte, mais aussi leur volonté de conserver leur mémoire, celle de l’Amérique, celle des opprimés. Le livre de Springer – et celui de Mosley qui montre l’influence du blues sur la littérature américaine – permet de comprendre ce présent du blues, pied de nez à l’histoire même de la formation sociale américaine.
Nicolas BENIES.