1974, une année noire
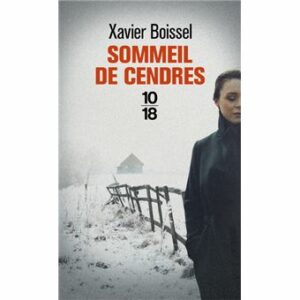 La mémoire de ce temps se trouve ravivée par Xavier Boissel qui place ses personnages dans ce moment qui, politiquement, de transition. Pompidou avait déjà largement rompu les amarres avec les « services spéciaux » du gaullisme, le SAC – Service Action Civique, pas mal comme intitulé pour des basses œuvres – notamment. Il leur avait coupé les subventions. Il fallait bien qu’il trouve d’autres sources de financement en s’acoquinant avec les anciens de l’OAS – ils s’étaient pourtant combattus – et la pègre. L’hypothèse, crédible, formulée par l’auteur pour trouver de l’argent, le trafic de drogue. Continuer la lecture
La mémoire de ce temps se trouve ravivée par Xavier Boissel qui place ses personnages dans ce moment qui, politiquement, de transition. Pompidou avait déjà largement rompu les amarres avec les « services spéciaux » du gaullisme, le SAC – Service Action Civique, pas mal comme intitulé pour des basses œuvres – notamment. Il leur avait coupé les subventions. Il fallait bien qu’il trouve d’autres sources de financement en s’acoquinant avec les anciens de l’OAS – ils s’étaient pourtant combattus – et la pègre. L’hypothèse, crédible, formulée par l’auteur pour trouver de l’argent, le trafic de drogue. Continuer la lecture
Archives mensuelles : août 2022
Polar : de la Croatie au Queens (New York City) pour finir dans l’espionnage
Le polar croate de Jurica Pavičić
 « L’eau rouge », publié l’an dernier, réussissait un tour de force, évoquer la guerre qui & déchiré l’ex-Yougoslavie sans jamais la mettre en scène, obscurcie qu’elle était par un drame familial : la disparition de Sylva, 17 ans, qui déchirera la famille et donnera au frère la possibilité de poursuivre le Graal, retrouver sa sœur. Il parcourra une partie du monde alors que son pays se déchire. Une quête sans fin qui se terminera par la découverte policière attendue et étrange tout à la fois. La découverte en France d’un auteur déjà reconnu dans son pays. (publication cet automne en poche)
« L’eau rouge », publié l’an dernier, réussissait un tour de force, évoquer la guerre qui & déchiré l’ex-Yougoslavie sans jamais la mettre en scène, obscurcie qu’elle était par un drame familial : la disparition de Sylva, 17 ans, qui déchirera la famille et donnera au frère la possibilité de poursuivre le Graal, retrouver sa sœur. Il parcourra une partie du monde alors que son pays se déchire. Une quête sans fin qui se terminera par la découverte policière attendue et étrange tout à la fois. La découverte en France d’un auteur déjà reconnu dans son pays. (publication cet automne en poche)
 « La femme du deuxième étage », pour cette année, creuse un autre filon de la littérature policière, le thriller, l’étude de caractère, le portrait d’une femme empoisonneuse, en prison au moment où le fil de cette vie commence, pour l’auteur qui la saisit dans l’univers carcéral dénué de violence pour parfaire la démonstration. L’enfermement des femmes est le fil conducteur de la trajectoire de Bruna, le nom de cette femme. Du coup, les personnages évoluent un peu trop en huis-clos, sans trop de lien avec la réalité d’un monde bouleversé par la guerre. En dehors des deux appartements et la prison, l’auteur, là, donne l’impression que le reste du monde n’existe que dans le rejet de la condamnée et de sa famille, sa mère en l’occurrence qui fuit la ville de Split, décrite à deux moments dans ses changements et ses constantes. L’auteur veut donner cette sensation d’enfermement et c’est un peu trop réussi. Il arrive que l’ennui gagne à force de lassitude qui semble habiter Bruna empêchée de prendre son destin en mains. La pression de l’entourage est pesante et empêche tout développement personnel. La prison est ressentie comme une libération par son rythme régulier, prévisible. Elle arrivera à se défaire de ses liens qui entravent sa capacité de penser par elle-même loin des contraintes sociales.
« La femme du deuxième étage », pour cette année, creuse un autre filon de la littérature policière, le thriller, l’étude de caractère, le portrait d’une femme empoisonneuse, en prison au moment où le fil de cette vie commence, pour l’auteur qui la saisit dans l’univers carcéral dénué de violence pour parfaire la démonstration. L’enfermement des femmes est le fil conducteur de la trajectoire de Bruna, le nom de cette femme. Du coup, les personnages évoluent un peu trop en huis-clos, sans trop de lien avec la réalité d’un monde bouleversé par la guerre. En dehors des deux appartements et la prison, l’auteur, là, donne l’impression que le reste du monde n’existe que dans le rejet de la condamnée et de sa famille, sa mère en l’occurrence qui fuit la ville de Split, décrite à deux moments dans ses changements et ses constantes. L’auteur veut donner cette sensation d’enfermement et c’est un peu trop réussi. Il arrive que l’ennui gagne à force de lassitude qui semble habiter Bruna empêchée de prendre son destin en mains. La pression de l’entourage est pesante et empêche tout développement personnel. La prison est ressentie comme une libération par son rythme régulier, prévisible. Elle arrivera à se défaire de ses liens qui entravent sa capacité de penser par elle-même loin des contraintes sociales.
Portrait d’une petite ville et d’une femme empêtrée dans la toile d’araignée des us et coutumes qui l’empêchent de vivre. Elle partira pour changer d’air.
« L’eau rouge », « La femme du deuxième étage », Jurica Pavičić – traduit par Olivier Lannuzel, Éditions Agullo
Portrait d’une firme néo-libérale sous Reagan
 « Queens Gansta » est une histoire de détournement. Un détournement ironique de l’idéologie néo-libérale à la Reagan pour le trafic de drogue. Autrement dit, comment faire fortune quand on est Noir aux États-Unis, à New York plus précisément, qu’on vit dans un quartier « défavorisé » – le Queens et plus précisément « South Jamaica » – en butte aux effets de la politique anti sociale de Reagan qui accroît la pauvreté ? « Preme » – pour Supreme – et Prince, son neveu, prennent l’exemple de la firme assoiffée de profit qui vend de la merde aux pauvres, pour construire leur trafic. C’est le temps, dans ce milieu des années 1980, du crack, le drogue du pauvre. Ils deviennent riches, créant des emplois pour tout le quartier, population attachée au trafic qui leur permet de survivre. Grande idée !
« Queens Gansta » est une histoire de détournement. Un détournement ironique de l’idéologie néo-libérale à la Reagan pour le trafic de drogue. Autrement dit, comment faire fortune quand on est Noir aux États-Unis, à New York plus précisément, qu’on vit dans un quartier « défavorisé » – le Queens et plus précisément « South Jamaica » – en butte aux effets de la politique anti sociale de Reagan qui accroît la pauvreté ? « Preme » – pour Supreme – et Prince, son neveu, prennent l’exemple de la firme assoiffée de profit qui vend de la merde aux pauvres, pour construire leur trafic. C’est le temps, dans ce milieu des années 1980, du crack, le drogue du pauvre. Ils deviennent riches, créant des emplois pour tout le quartier, population attachée au trafic qui leur permet de survivre. Grande idée !
Karim Madani raconte l’aventure des deux initiateurs, capitalistes dans l’âme qui aurait pu devenir capitaines d’industrie s’ils avaient été Blancs. Dans un premier temps la Police se désintéresse de ces trafiquants, de ces règlements de comptes entre Noirs mais la puissance de l’entreprise devient telle qu’il faut sévir contre ces Noirs un peu trop arrogants qui se permettent même de tuer un flic blanc.
L’aventure se termine à la fin des années 1980. En prison. Il reste un goût amer pour toute cette jeunesse perdue dans une ville qui ne reconnaît pas au même titre toutes ses populations, d’un pays où règne encore la ségrégation raciale. L’auteur s’agite autour de ces contradictions : la valorisation d’un projet qui provoque la mort de jeunes gens, la perte de toutes ces vies vouées à la destruction et la mise en cause de politiques incapable de développer les compétences à cause de la couleur de la peau. Un réquisitoire contre toutes ces politiques publiques de remise en cause à la fois des acquis sociaux et des libertés démocratiques.
Un bémol toutefois : il faudrait alléger le style, le travailler davantage.
Nicolas Béniès
« Queen Gansta », Karim Madani, Rivages/Noir
« Espionnage », une nouvelle collection « Noire ».
 Inaugurer cette collection avec « Des hommes sans nom » mettant en scène une femme espion, Victoire Le Lidec, de sa formation à sa première infiltration dans les réseaux de Daesh en 2017, est une bonne façon d’entrer dans cet univers. Analyste à la Direction générale de la sécurité extérieure, elle conçoit des plans pour infiltrer cette organisation notamment une formation de femmes capables de participer à des attentats.
Inaugurer cette collection avec « Des hommes sans nom » mettant en scène une femme espion, Victoire Le Lidec, de sa formation à sa première infiltration dans les réseaux de Daesh en 2017, est une bonne façon d’entrer dans cet univers. Analyste à la Direction générale de la sécurité extérieure, elle conçoit des plans pour infiltrer cette organisation notamment une formation de femmes capables de participer à des attentats.
Hubert Maury et Marc Victor, l’un ex-casque bleu, l’autre journaliste, ont uni leurs compétences pour construire ce roman qui s’appuie sur des données géopolitique et des situations vraisemblables. Bien écrit, ils projettent leur héroïne et son instructeur, Nicolaï Kozel dans ce monde étrange de faux-semblants, de guerre des services secrets, des politiques des différents Etats où le secret règne en maître pour dessiner l’envers du décor.
Une réussite.
Nicolas Béniès
« Des hommes sans nom », Maury-Victor, Gallimard, « Espionnage ».
Mémoires en mouvement par les femmes
Une grande romancière ignorée en France…jusqu’à présent.
 Gayl Jones, éditée pour la première fois par Tony Morrison – prix Nobel de littérature 1993 qui nous a quittés récemment – en 1975 pour « Corregidora » aujourd’hui traduit en français. Dés sa parution, nous indique l’éditeur Dalva, ce roman a été considéré comme un classique et enseigné dans les écoles. A le lire, on en comprend les raisons.
Gayl Jones, éditée pour la première fois par Tony Morrison – prix Nobel de littérature 1993 qui nous a quittés récemment – en 1975 pour « Corregidora » aujourd’hui traduit en français. Dés sa parution, nous indique l’éditeur Dalva, ce roman a été considéré comme un classique et enseigné dans les écoles. A le lire, on en comprend les raisons.
L’autrice dessine les contours d’un portrait de femme africaine-américaine, chanteuse soumise au joug des hommes et habitée par des toutes les femmes vivantes en elle. Son arrière-grand-mère, esclave tributaire de son maître qui la viole, le Corregidora du titre, sa grand-mère, prostituée par le même ou ses descendants qui pourrait être aussi son père, sa mère et elle comme la résultante de toutes ses trajectoires et mémoires tout en voulant se construire avec et contre toutes les traces du passé. Un puzzle dont les pièces ont tendance à vivre leur vie sans s’imbriquer totalement les unes aux autres, un puzzle toujours à refaire pour rechercher la pièce manquante.
Ursa, le nom de la chanteuse de blues du Kentucky dont quelques traits sont empruntés à Billie Holiday – citée par la romancière – vivra dans votre esprit pour incarner une femme capable de se dépasser pour assumer sa liberté. Écrire ou parler des femmes ne pourra plus faire l’économie de Gayl Jones. Un grand roman, une grande romancière qui a su puiser dans les itinéraires des grandes chanteuses de jazz et dans la poésie parfois crue des blues qui savent que cette musique du diable – comme on l’appelait aux États-Unis, surtout dans les États du Sud – est façonnée autant pat l’âme que par le corps, Body and Soul, pour citer le titre d’un standard du jazz.
Nicolas Béniès
« Corregidora », Gayl Jones, traduit par Madeleine Nasalik, Dalva éditions.
