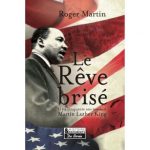Retour vers le futur.
 Le climat actuel, centenaire du premier disque de jazz oblige peut-on croire, est fait d’un retour vers les origines, le moment où rien n’est codifié, où tous les alliages, les collages sont possibles et ressentis comme nécessaires. Une sauvagerie que Darius Milhaud voulait retrouver. La sauvagerie de la création est une des manières de lutter contre la violence du monde. Manière de faire se rencontrer les révolutions du jazz, celle des premiers temps, de ces années 20 rugissantes, avec celle de ces années 60 appelée « Free Jazz », une sorte de libération profonde à la fois des codes, de tous les codes y compris ceux de la musique et du corps.
Le climat actuel, centenaire du premier disque de jazz oblige peut-on croire, est fait d’un retour vers les origines, le moment où rien n’est codifié, où tous les alliages, les collages sont possibles et ressentis comme nécessaires. Une sauvagerie que Darius Milhaud voulait retrouver. La sauvagerie de la création est une des manières de lutter contre la violence du monde. Manière de faire se rencontrer les révolutions du jazz, celle des premiers temps, de ces années 20 rugissantes, avec celle de ces années 60 appelée « Free Jazz », une sorte de libération profonde à la fois des codes, de tous les codes y compris ceux de la musique et du corps.
Julian Lage, guitariste découvert pour nous aux côtés de Gary Burton, ouvre ses compositions en emmêlant, avec une joie communicative façon de renouer avec la danse, les danses, à tous les vents des grands espaces de ces Etats-Unis d’Amérique qui semblent avoir perdu le goût de la liberté. La « country » prend toute sa place sans oublier les jazz, tous les jazz. Une sorte de souffle bleu qui emporte tout sur son passage. Au-dessus de tout, la guitare capable de tous les sauts, de toutes les acrobaties pour faire sentir la musique autrement. Le trio, habituel de Lage, Scott Colley à la contrebasse et Kenny Wollesen à la batterie (et un peu au vibraphone) habitent les compositions de Lage.
Le titre même de l’album, « Modern Lore », est à lui seul un programme. En forme d’oxymore : moderne s’applique aux connaissances traditionnelles et c’est bien cette réflexion qui est au centre de cette musique.
Nicolas Béniès.
« Modern Lore », Julian Lage, Mack Avenue distribution PIAS