1974, une année noire
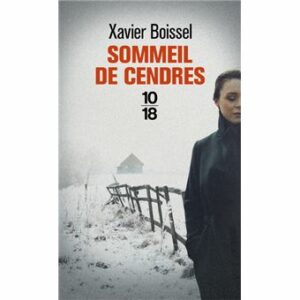 La mémoire de ce temps se trouve ravivée par Xavier Boissel qui place ses personnages dans ce moment qui, politiquement, de transition. Pompidou avait déjà largement rompu les amarres avec les « services spéciaux » du gaullisme, le SAC – Service Action Civique, pas mal comme intitulé pour des basses œuvres – notamment. Il leur avait coupé les subventions. Il fallait bien qu’il trouve d’autres sources de financement en s’acoquinant avec les anciens de l’OAS – ils s’étaient pourtant combattus – et la pègre. L’hypothèse, crédible, formulée par l’auteur pour trouver de l’argent, le trafic de drogue.
La mémoire de ce temps se trouve ravivée par Xavier Boissel qui place ses personnages dans ce moment qui, politiquement, de transition. Pompidou avait déjà largement rompu les amarres avec les « services spéciaux » du gaullisme, le SAC – Service Action Civique, pas mal comme intitulé pour des basses œuvres – notamment. Il leur avait coupé les subventions. Il fallait bien qu’il trouve d’autres sources de financement en s’acoquinant avec les anciens de l’OAS – ils s’étaient pourtant combattus – et la pègre. L’hypothèse, crédible, formulée par l’auteur pour trouver de l’argent, le trafic de drogue.
« Sommeil de cendres » – le titre aurait pu être « un mort vivant revit » ou l’amour fait des miracles – se situe dans ce contexte. L’année se terminant par l’élection de Giscard avec le soutien de Chirac et des assassinats des responsables du SAC. Deux personnages animent l’intrigue qui part de l’assassinat d’un étudiant « maoïste » – en fait de VLR, Vive la Révolution, les maos dits « spontex » dans le langage de ce temps lointain – dont le cadavre portant des traces de torture est retrouvé par hasard.
Histoire d’un amour fou, « union du désespoir et de l’impossible » comme le définissait Maxwell, un poète anglais du 18e, unissant le policier chargé de l’enquête, Eperlan, mort-vivant rescapé de l’engagement français dans les troupes onusiennes en Corée en 1952 – épisode oublié – et Alexia Schwartz, jeune femme qui avait fait son service militaire en Israël au moment de la guerre des 6 jours. Elle est poursuivie par les barbouzes du SAC, de la pègre pour récupérer l’argent volé par son amant assassiné.
L’auteur émaille sa prose d’emprunts, de citations qui n’en sont pas, de quoi construire un jeu de pistes différentes de l’histoire qu’il raconte.
Les cendres sont multiples même si le sommeil est unique, les rallumer pourrait provoquer des feux d’artifice qui sortiraient les individus de leur torpeur et de leur mort.
Nicolas Béniès
« Sommeil de cendres », Xavier Boissel, 10/18
Cracovie 1893
 La Pologne a disparu englouti dans l’Empire Austro-hongrois et Cracovie est une ville provinciale avec tous ses préjugés, ses manières de vivre sous le regard des autres, le respect de la bienséance est nécessaire et même dans ce cas les commérages vont bon train. Maryla Szymiczkowa – pseudonyme de deux auteurs, Jacek Dehnel et Piotr Tarczynski, chacun ayant une carrière propre – a décidé, au travers d’enquêtes policières, de faire l’histoire de la ville de Cracovie jusqu’en 1946. Une fresque !
La Pologne a disparu englouti dans l’Empire Austro-hongrois et Cracovie est une ville provinciale avec tous ses préjugés, ses manières de vivre sous le regard des autres, le respect de la bienséance est nécessaire et même dans ce cas les commérages vont bon train. Maryla Szymiczkowa – pseudonyme de deux auteurs, Jacek Dehnel et Piotr Tarczynski, chacun ayant une carrière propre – a décidé, au travers d’enquêtes policières, de faire l’histoire de la ville de Cracovie jusqu’en 1946. Une fresque !
Pour cette entrée en matières, nous faisons connaissance avec l’héroïne principale Zofia Turbotynska, femme au foyer d’une quarantaine d’années sorte de Miss Marple – référence assumée à Agatha Christie – femme de professeur d’université. Comme toute femme de son rang, elle se targue d’opérations de bienfaisance, ici des enfants victimes de lésions cutanées, des enfants scrofuleux en organisant une loterie. La Maison Helcel, tenue par des religieuses, est un lieu qui accueille des vieilles dames, pensionnaires de l’institution comme les enfants. Une de ces pensionnaires, « Madame Mohr a disparu », point de départ de l’enquête.
Zofia fait preuve d’un redoutable sens de l’observation et de déduction tout en respectant apparemment l’étiquette de son milieu.
Les auteurs en profitent pour décrire ce milieu en pastichant des auteurs que le lecteur français ne connaît pas forcément provoquant de temps en temps une certaine torpeur devant la multiplicité des descriptions. Un guide aurait été nécessaire.
Malgré tout, entrer dans ce labyrinthe que représente Cracovie à ce moment là. Vous y trouverez les artistes importants comme la configuration de la société de l’époque même si vous ne riez pas autant – semble-t-il – que le lecteur polonais. Il est possible, aussi, de trouver quelques références dissimulées à la Pologne d’aujourd’hui.
Nicolas Béniès
« Madame Mohr a disparu », Maryla Szymiczkowa, traduit par Marie Furman-Bouvard, Agullo/Noir
Ratisbonne, août 1662
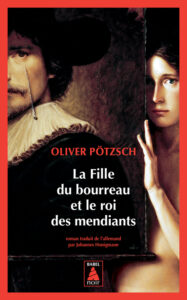 Olivier Pötzsch a créé un personnage de bourreau – de la ville de Schongau – Jacob Kuisl – se prononce « couizeul » comme nous renseigne le traducteur Johannes Honigmann – pour décrire la vie du 17e siècle allemand. Les villes cherchent à s’émanciper de la tutelle des Nobles pour développer leurs commerces et leur industrie. Apparaissent – comme en Angleterre un peu plus tôt – les « hommes libres », confrérie d’artisans. Les luttes sociales et la « guerre de 30 ans » – terminée en 1662 – marque les esprits et les comportements.
Olivier Pötzsch a créé un personnage de bourreau – de la ville de Schongau – Jacob Kuisl – se prononce « couizeul » comme nous renseigne le traducteur Johannes Honigmann – pour décrire la vie du 17e siècle allemand. Les villes cherchent à s’émanciper de la tutelle des Nobles pour développer leurs commerces et leur industrie. Apparaissent – comme en Angleterre un peu plus tôt – les « hommes libres », confrérie d’artisans. Les luttes sociales et la « guerre de 30 ans » – terminée en 1662 – marque les esprits et les comportements.
« La fille du bourreau et le roi des mendiants » raconte l’histoire de la ville lieu de luttes géopolitiques entre le pouvoir ottoman, les villes italiennes et le reste de l’Europe en même temps que le combat interne entre l’Empire, pouvoir politique, l’Église et la municipalité de la ville « libre ». Les instances institutionnelles de l’Empire doivent s’y réunir transformant la ville en un tissu d’intrigues pour développer son propre réseau d’influences au mépris de toute vie humaine. Une grande leçon d’histoire.
Le bourreau, lui, est inséré dans ces fils bizarres qu’il ne peut maîtriser, dans une ville qu’il ne connaît pas où il est venu secourir sa sœur. Il est la proie d’une vengeance qui remonte à la guerre, 25 ans plus tôt.
L’auteur fait passer cette double intrigue par les yeux et la réflexion naïve de Magdalena, la fille du bourreau et de son mari, Simon, médecin de son état qui en restent souvent aux apparences. Le roi des mendiants apporte son aide intéressée, manière de décrire les bas fonds et la cour des miracles qui existent dans toutes les villes.
Une réussite. En prime, visite commentée de Ratisbonne.
Nicolas Béniès
« La fille du bourreau et le roi des mendiants », Olivier Pötzsch, traduit par Johannes Honigmann, Babel/Actes Sud
