Paris, 1923
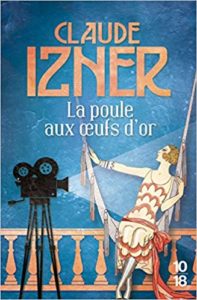 La saga des sœurs Izner dans ce Paris des années 20, étrange, secoué par le jazz, les comédies musicales, Cocteau, les surréalistes, la révolution russe… se poursuit dans ce troisième opus, « La poule aux œufs d’or ». Le narrateur, pianiste de jazz, américain, Jeremy Nelson – il a rencontré, dans l’ouvrage précédent « La femme au serpent », la famille de Victor Legris pour relier des histoires du 20e et du 19e siècle – se transforme en enquêteur tout en nous faisant visiter certains lieux du Paris «qui « jazze ». Dans cette troisième enquête, il est engagé par le… cinéma. C’est une des grandes bizarreries du cinéma muet : la musique est nécessaire pour mettre les acteurs dans l’ambiance. La musique et le cinéma opérait déjà leur histoire d’amour/haine.
La saga des sœurs Izner dans ce Paris des années 20, étrange, secoué par le jazz, les comédies musicales, Cocteau, les surréalistes, la révolution russe… se poursuit dans ce troisième opus, « La poule aux œufs d’or ». Le narrateur, pianiste de jazz, américain, Jeremy Nelson – il a rencontré, dans l’ouvrage précédent « La femme au serpent », la famille de Victor Legris pour relier des histoires du 20e et du 19e siècle – se transforme en enquêteur tout en nous faisant visiter certains lieux du Paris «qui « jazze ». Dans cette troisième enquête, il est engagé par le… cinéma. C’est une des grandes bizarreries du cinéma muet : la musique est nécessaire pour mettre les acteurs dans l’ambiance. La musique et le cinéma opérait déjà leur histoire d’amour/haine.
« La poule aux œufs d’or » – un titre qui ne s’explique pas totalement – raconte surtout les trajectoires de « russes blancs » qui ont refusé la révolution en choisissant l’exil pour se retrouver loufiat, chauffeur de taxi ou autre métier à la qualification empirique. Le choix était limité pour la plupart d’entre eux et plus encore pour elles. Certain-ne-s n’étaient pas partis sans rien. C’est le cas ici. La chasse au trésor s’ouvre. Ici, l’auteure prend pour personnage une professeure de diction. Les actrices de cinéma pensent au théâtre, à Sara Bernhardt et à ses funérailles nationales, pour devenir des « vrais » comédiennes. Les débuts du cinéma parlant, comme le raconte le film de Stanley Donen et Gene Kelly, « Singin’ in the rain », leur donneront du travail.
S’entremêlent la chasse au trésor – une trousse de couture – qui fait des mort-e-s, la réalisation du film, les scènes de la vie quotidienne via la petite fille des bouchers, la littérature et le jazz. Un cocktail qui incite à suivre les aventures de Jeremy Nelson. Il y faudrait la bande son pour évoquer cette période faite de sauvage joie de vivre, d’alcool, de nuits ruisselantes et de gueules cassées.
Nicolas Béniès.
« La poule aux œufs d’or », Claude Izner, 10/18
Un conte noir.
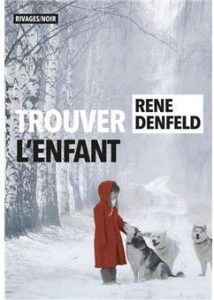 « Trouver l’enfant » est un titre à tiroirs. Trouver l’enfant qui a disparu, un jour, dans l’Oregon alors que les parents s’échinaient à trouver un vrai sapin. La neige a tout recouvert, les traces comme les cris des parents et, peut-être, de la petite fille. Madison Culver était – est ? – son nom. Les parents font appel à une enquêtrice, Naomi Cottle, dernier espoir. Elle part dans ces contrées isolées où le froid semble régner en permanence, où les villages n’existent pas, seules subsistent des maisons isolées où tout peut se passer à l’abri de tout les regards, où les rencontres sont quasi inexistantes. Le commerce des peaux d’animaux est toujours présent et permet à quelques trappeurs de survivre. Un paysage fantomatique qui digère tous les indices, toutes les traces. Les pistes existent mais il faut prendre le temps, celui de l’éternité, de les trouver.
« Trouver l’enfant » est un titre à tiroirs. Trouver l’enfant qui a disparu, un jour, dans l’Oregon alors que les parents s’échinaient à trouver un vrai sapin. La neige a tout recouvert, les traces comme les cris des parents et, peut-être, de la petite fille. Madison Culver était – est ? – son nom. Les parents font appel à une enquêtrice, Naomi Cottle, dernier espoir. Elle part dans ces contrées isolées où le froid semble régner en permanence, où les villages n’existent pas, seules subsistent des maisons isolées où tout peut se passer à l’abri de tout les regards, où les rencontres sont quasi inexistantes. Le commerce des peaux d’animaux est toujours présent et permet à quelques trappeurs de survivre. Un paysage fantomatique qui digère tous les indices, toutes les traces. Les pistes existent mais il faut prendre le temps, celui de l’éternité, de les trouver.
L’enquêtrice a, elle-même un secret, qu’elle n’arrive pas à cerner seulement présent dans ses cauchemars et qu’elle cherche à percer. Pour ce faire, elle a besoin de « trouver l’enfant » qu’elle fut pour se comprendre, s’accepter.
Plusieurs contes se chevauchent. Celui que se raconte le petite fille pour ne pas se perdre, pour conserver les liens avec le passé, un conte de mémoire. Celui de l’enquêtrice qui doit chercher dans son passé occulté les chemins qui lui permettront de retrouver la petite fille et celui de l’homme qui a recueilli l’enfant voulant croire à un amour interdit.
Tout est noir dans la blancheur des paysages. Les contes transcendent la réalité pour en exprimer la quintessence. Ils mettent en scène des mythes pour obliger la réalité à sortir du mensonge. Rene Denfeld a réussi à nous enchanter pour mieux distiller l’angoisse d’un monde retombé dans l’enfance qui n’est ni innocence, ni fraternité mais violence.
Nicolas Béniès
« Trouver l’enfant », Rene Denfeld, traduit par Pierre Bondil, Rivages/Noir
.
