Mythologies américaines.
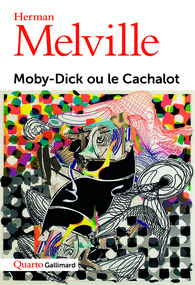 « Moby-Dick ou le Cachalot » fait partie des textes étudiés à l’école comme partie de la littérature mondiale, une raison suffisante pour ne pas le lire ou le relire. Herman Melville pourtant joua un rôle essentiel dans la construction des mythes adoptés par les Etats-Unis. Les références à la baleine blanche – le blanc est la « couleur » de Melville – sont multiples et se retrouvent chez Hemingway comme chez Philip Roth. Il représente la première tentative d’émanciper les lettres américaines de la tutelle britannique.
« Moby-Dick ou le Cachalot » fait partie des textes étudiés à l’école comme partie de la littérature mondiale, une raison suffisante pour ne pas le lire ou le relire. Herman Melville pourtant joua un rôle essentiel dans la construction des mythes adoptés par les Etats-Unis. Les références à la baleine blanche – le blanc est la « couleur » de Melville – sont multiples et se retrouvent chez Hemingway comme chez Philip Roth. Il représente la première tentative d’émanciper les lettres américaines de la tutelle britannique.
A l’instar du « Don Quichotte » de Cervantès qui savait construire un continent avec ses propres rêves, Melville ironise sur les livres censés décrire les « travailleurs de la mer » pour se dégager d’une certaine réalité devenant ambivalente et enfermer le capitaine Achab – mais aussi le narrateur Ismaël – dans un espace temps en train de se construire. Moby Dick, tel que le cachalot est appelé dans le cours du livre, a perdu son trait d’union – la ponctuation ne doit pas être traitée à la légère – évolue sans cesse entre un monstre de contes et la réalité de la pêche qui deviendra, peu après la publication du livre, industrielle détruisant la biodiversité des océans. Le trait d’union représente cet aller-retour entre le concept – l’idée comme il est écrit dans le texte – et la réalité du cachalot.
Comment qualifier ce texte : roman, récit, conte, légende… ? Il ne tranche pas. L’influence de l’Ancien Testament est perceptible, dans les noms des protagonistes, dans les références tout comme Shakespeare, Montaigne, Rabelais et les histoires que se racontent les marins lorsque le temps et le vent sont paresseux.
Philippe Jaworski, qui a fait sa thèse sur Melville, met en évidence toutes ces données et propose, pour son édition dans la collection Quarto, à la fois sa traduction – qui reprend celle des éditions de La Pléiade – et des illustrations de Rockwell Kent (1882-1971) pour un livre que ce dernier publiera en 1930. C’est une première. Les dessins n’avaient jamais été publiés en France, même s’ils ne sont pas repris dans leur totalité. Ils donnent plus de force au texte par une interprétation qui force à réfléchir sur notre propre vision du récit de Melville.
L’image de couverture de cette édition critique est due, quant à elle, à Frank Stella (né en 1936) qui a consacré, nous dit Jaworski, 12 ans de son activité à illustrer Moby-Dick. Pour indiquer que ce cachalot ne laisse pas indifférent, ni le combat entre Achab et Moby Dick qui représente quasiment un résumé de la société américaine de cette époque embarquée sur le « Pequod » – « Pequots » comme l’indique un glossaire des noms propres, est le nom d’une tribu amérindienne disparue au moment où écrit Melville.
Ce livre, comme tous les rêves, ne se termine pas. Il se brise. Il est loisible de s’interroger si Ismaël, le narrateur, a vécu cette histoire ou s’il exprime sa soif d’aventures… comme le lecteur. Il faut savoir rêver pour vivre pleinement nos vies et faire entrer son quotidien dans l’extraordinaire.
Nicolas Béniès.
« Moby-Dick ou le Cachalot », Herman Melville traduit, présenté par Philippe Jaworski, Quarto/Gallimard, 1024 p., 146 documents, 25 euros.
