Fragments littéraires.
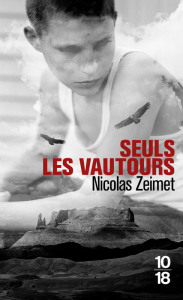 Nicolas Zeimet, né en 1977, vit à Paris et s’est nourri de littérature américaine. « Seuls les vautours » en fait la démonstration. Ce roman est rempli jusqu’à la garde de références de polars américains. Et au-delà. De tous les romanciers de la Série Noire des premiers temps, de ces Britanniques, comme James Hardley Chase, qui ont su servir cette littérature dite de gare. Marcel Duhamel en avait bien compris l’intérêt. Zeimet souhaite à sa manière les 70 ans de la collection. Les noms des policiers signent ces références. Pour en donner un exemple, Robicheaux pour aller du côté de James Lee Burke et beaucoup d’autres à retrouver.
Nicolas Zeimet, né en 1977, vit à Paris et s’est nourri de littérature américaine. « Seuls les vautours » en fait la démonstration. Ce roman est rempli jusqu’à la garde de références de polars américains. Et au-delà. De tous les romanciers de la Série Noire des premiers temps, de ces Britanniques, comme James Hardley Chase, qui ont su servir cette littérature dite de gare. Marcel Duhamel en avait bien compris l’intérêt. Zeimet souhaite à sa manière les 70 ans de la collection. Les noms des policiers signent ces références. Pour en donner un exemple, Robicheaux pour aller du côté de James Lee Burke et beaucoup d’autres à retrouver.
L’intrigue est simple et plutôt classique. Elle fait penser aux auteurs contemporains, Dennis Lehane en particulier même si le lieu où les vautours se complaisent est une petite ville, Duncan’s Creek. Une bourgade sise dans l’Utah dans laquelle les habitant(e)s ont l’air de tous se connaître. Comment se fait-il qu’une petite fille de 5 ans se soit fait enlever et par qui ? En cette année 1985, 4e année de l’ère Reagan, le passé fait totalement parti du présent. Il le structure.
Les recherches commencent. La presse nationale et locale est mobilisée. A chaque arrivée d’un nouveau personnage, l’auteur se fait un plaisir de nous le présenter. Au bout d’un moment, le procédé devient fastidieux même s’il évite à l’auteur de se prendre pour Dieu et de se mettre dans la tête de tous les protagonistes. La mise bout à bout de fiches de police – la NSA devait déjà exister – donne l’impression d’une litanie au lieu de vies qu’il faudrait vivre. Il aurait fallu le dynamiter, le faire exploser.
Il ne recule pas devant les légendes indiennes (titre de sa troisième partie) qu’il détaille avec une alacrité étrange. Une sorte de revanche peut-être, revanche du destin de ces « native lands » comme on disait déjà aux États-Unis en cette période reculée. Une revanche qu’il prend à son compte. Une plongée dans l’enfance ?
La touche originale tient dans la place donnée aux enfants, à leurs relations souvent barbares, à leurs amitiés et à leurs amours, aux phénomènes de bandes, à leur manière de conjurer la peur, l’angoisse. On est pourtant loin de la verve de Charles Williams et de sa « Fantasia chez les ploucs » et de narrateur de 7 ans, Billy, qui raconte ce qu’il voit sans rien comprendre. ici les enfants sont enfermés dans des familles dont les secrets sont seulement suggérés. Une veine à creuser…
Certains personnages sortent du cadre. Le couple formé de la maîtresse d’école aux secrets enfouis – qui sortiront, je vous rassure – et du propriétaire du journal local, le médecin blanc et de son ami noir, les jeunes gens qui s’aiment, la colère inépuisable du jeune homme de 19 ans, une sorte de rappel de Marlon Brando ou de James Dean même si l’époque ne correspond pas… sont, en même temps, l’armature de l’intrigue plus que l’enlèvement en lui-même. L’amour est l’autre thème essentiel.
Au bout des 547 pages de cette édition, il fallait bien trouver une fin. Il a choisi, après bien des hésitations je suppose, la plus facile. La schizophrénie est une clé habituelle de tous ces enlèvements et meurtres d’enfants. Dommage. J’aurai aimé être surpris par… l’absence de fin. Pourquoi tout expliquer ?
Il reste que Nicolas Zeimet a « quelque chose » dans l’écriture qui oblige le lecteur à avancer malgré tout, malgré son énervement devant les détails qui s’accumulent, devant les références trop multiples, devant les emprunts à la littérature américaine tellement visibles qu’ils deviennent partie prenante d’un style qui fait de ce collage sa pierre de touche.
Il faut lire cet auteur. Si les petits cochons ne le mangent pas, il a de l’avenir…
Nicolas Béniès.
« Seuls les vautours », Nicolas Zeimet, 10/18
