CHARLIE PARKER AURAIT EU, EN AOUT 1995, 75 ANS, 100 ans en 2020.
ACTUALITE DE CHARLIE PARKER
BIRD LIVES !
Une réédition en poche d’un livre paru en 1980, « Bird lives » de >Ross Russell (chez 10/18) et un double CD, « Young Bird », dans la collection Masters of Jazz de Média 7, attirent l’attention, de nouveau, sur le génie de la musique que fut « Bird », Charlie Parker. On sait, au moins depuis le film de Clint Eastwood, que l’Oiseau est le surnom de Parker, provenant soit de « Poulet » – il en aurait écrasé un, en auto, ou allusion à son appétit – soit de « Yardbird », le « bleu », le « tire au flanc », comme le rappelle Alain Tercinet dans le livret du CD. Comme le rappelle « Down Beat », la première revue de jazz américaine, il aurait eu 75 ans cette année.  Il était né le 29 août 1920. Et l’Oiseau est toujours vivant !
Il était né le 29 août 1920. Et l’Oiseau est toujours vivant !
Il reste, pour l’éternité, Bird, l’Oiseau, toujours vivant comme l’indique le titre du livre de Ross Russell, pour l’auditeur comme pour le lecteur. Bird serait mort à 35 ans, en 1955… Mais dés qu’il embouche ce saxophone alto, les ailes se dressent indiquant le départ pour l’espace de la liberté totale. L’oiseau de liberté tel est Parker. Il ne pouvait que se brûler les ailes, indéfiniment, à l’instar d’Icare. Comme lui, il exprime notre fond commun d’humanité. Ou comme Prométhée, il ne pouvait que se faire manger le foie pour l’éternité…
Tercinet retrace rapidement les premières années de Bird à KC – Kay Ci, Kansas City -, ville douce pour les musiciens de jazz couverts par le système Pendergast institutionnalisant la corruption, mais sans débordements sanglants, et ses clubs ouverts toute la nuit. La ville, comme le raconta le batteur Jo Jones – le batteur de l’orchestre de Basie, fondateur de la batterie moderne – vivait au son de musique de jazz, le jour et la nuit. Environnement qui explique, en partie le génie de Parker.
Comment naît un génie ? Le jeune Parker n’était pas spécialement

La nouvelle édition des œuvres pas complètes du Bird toujours sous l’égide de Alain Tercinet qui nous a quittés l’an dernier, pour éviter le centenaire. (Frémeaux et associés)
Il faudra attendre qu’il ait 17 ans pour le voir étudier son instrument, copier les solos de Lester Young, ce qu’il niera plus tard, et apprendre l’essentiel de son art avec le saxophoniste alto et chef d’orchestre Buster Smith, peu connu parce qu’il a refusé de quitté KC et de suivre Basie. Il devient une véritable éponge. Il absorbe toute la musique qu’il entend autour de lui, et devient même plongeur dans le club où joue le pianiste virtuose Art Tatum, pour en 1939 éclater à la face du monde. Il est Parker. Son apprentissage est terminé. Il lui manque encore la rencontre avec le trompettiste Dizzy Gillespie, pour arriver au  génie, à la révolution des formes du jazz. Ce sera pour le volume 3… Déjà là, les prémices du génie sont perceptibles. Déjà là, et dés 1939, Parker ne joue pas comme les autres saxophones alto. Ses idées restent latentes, mais il sait ce qu’il n’est pas. Il lui faut maintenant devenir lui-même. Le CD 1 débute avec un enregistrement privé, dont une grande partie – plus de 3mn, sur 3mn 39s – avait été publié par le label « Stash » et faussement daté de 1937. En fait, et nous sommes convaincus par les explications données, mi-1940 convient mieux. Il fait entendre Parker en solo absolu, et ces 39 secondes supplémentaires apparaissent comme un cadeau du ciel (ou de l’enfer). Il faut passer outre la mauvaise qualité de l’enregistrement pour tendre l’oreille vers le génie en formation. De même sont de très mauvaise qualité technique les faces qui suivent provenant d’une chaîne de radio de Wichita, avec l’orchestre de Jay McShann. Mais les enregistrements officiels subissaient le « Petrillo ban », la grève des personnels techniques.
génie, à la révolution des formes du jazz. Ce sera pour le volume 3… Déjà là, les prémices du génie sont perceptibles. Déjà là, et dés 1939, Parker ne joue pas comme les autres saxophones alto. Ses idées restent latentes, mais il sait ce qu’il n’est pas. Il lui faut maintenant devenir lui-même. Le CD 1 débute avec un enregistrement privé, dont une grande partie – plus de 3mn, sur 3mn 39s – avait été publié par le label « Stash » et faussement daté de 1937. En fait, et nous sommes convaincus par les explications données, mi-1940 convient mieux. Il fait entendre Parker en solo absolu, et ces 39 secondes supplémentaires apparaissent comme un cadeau du ciel (ou de l’enfer). Il faut passer outre la mauvaise qualité de l’enregistrement pour tendre l’oreille vers le génie en formation. De même sont de très mauvaise qualité technique les faces qui suivent provenant d’une chaîne de radio de Wichita, avec l’orchestre de Jay McShann. Mais les enregistrements officiels subissaient le « Petrillo ban », la grève des personnels techniques.
Le CD 2 reprend les enregistrements de fortune réalisés par le collectionneur Bob Redcross – explication d’un des titres de Parker – là aussi de mauvaise qualité technique, et pourtant indispensable pour comprendre, apprécier le parcours parkérien. Il n’a que 23 ans en cette année 1943 – il est né le 29 août 1920 – et sans « Redcross » nous ne saurions rien de sa manière de jouer à ce moment là, grève obligeant. Les amateurs ne pourront ignorer ce double album qui donne à entendre l’enfance d’un génie, l’enfance du bop.
Ross Russell – que Tercinet2 bizarrement ne cite pas – fait la part belle à la légende, ou aux lieux communs pour les premières années de Parker. Pour avoir une vision plus proche de la réalité, le travail méthodique et scientifique de Gary Giddins – « Le triomphe de Charlie Parker », aux éditions Denoël, 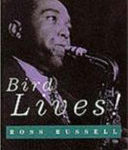 que Tercinet ne cite pas non plus – est de loin préférable. Par contre le témoignage de Russell est incontournable pour les enregistrements, indispensables pour tous ceux et toutes celles qui veulent apprécier le génie de Parker, de 1946-47 réalisés pour le
que Tercinet ne cite pas non plus – est de loin préférable. Par contre le témoignage de Russell est incontournable pour les enregistrements, indispensables pour tous ceux et toutes celles qui veulent apprécier le génie de Parker, de 1946-47 réalisés pour le  label « Dial », qu’il avait fondé uniquement pour enregistrer Parker. Il y raconte la difficulté des sessions avec Parker, malade, et la manière dont ce chef d’oeuvre, « Lover man », a été créé par un Parker qui laisse parler son âme, son inconscient dirait Freud, qui se déshabille entièrement montrant notre propre humanité, dévoilant des images enfouies dans le plus profond tréfonds de notre cerveau.
label « Dial », qu’il avait fondé uniquement pour enregistrer Parker. Il y raconte la difficulté des sessions avec Parker, malade, et la manière dont ce chef d’oeuvre, « Lover man », a été créé par un Parker qui laisse parler son âme, son inconscient dirait Freud, qui se déshabille entièrement montrant notre propre humanité, dévoilant des images enfouies dans le plus profond tréfonds de notre cerveau.
Chaque fois que Russell cite le trompettiste Red Rodney, il faut traduire par affabulation, et les lire comme le délire d’un homme qui a passé trop de temps avec ses rêves et ses cauchemars provoqués par l’abus de substances interdites. Hormis ces précautions, il faut lire le livre de Russell comme un hommage à l’Oiseau. Russell visiblement n’a plus été le même avant et après sa rencontre avec Parker. En fait il parle indirectement de sa transformation. Pour lui, pour moi, comme pour tous les auditeurs de Parker, l’Oiseau reprend son vol, éternel albatros qui ne peut marcher sur la terre, ferme pour certains, mouvante pour lui. Il veut un nouveau monde, monde de liberté, d’égalité, de fraternité, monde impossible dans les États-Unis de l’époque et d’aujourd’hui. Et nous ne parlons pas de la France…
Lire Ross Russell – la traduction de Mimi Perrin est un modèle du genre – c’est écouter une improvisation sur une vie qui métamorphose une autre vie. C’est un témoignage, pas une leçon d’histoire…
Nicolas BENIES
Petite note discographique. Après les enregistrements Dial, Parker sera sous contrat avec Norman Granz, qui essaiera de lui faire dépasser la frontière des amateurs de jazz, pour qu’il aille à la rencontre du succès, autrement dit du public blanc. Il le fera donc enregistrer – Parker en avait envie – avec des cordes, que Verve (distribué par Polygram, devenu Universal) vient de rééditer en CD : “ Charlie Parker with strings : The Master Takes ”, qui regroupe l’ensemble de ces rencontres de l’Oiseau et d’un tout petit extrait d’un orchestre symphonique, rencontres qui méritent le détour.
La dernière réédition Verve est une compilation des petits groupes que formait Parker, où l’on retrouve Dizzy Gillespie et Monk pour trois plages, Miles Davis, Kenny Dorham, Red Rodney, pour en rester aux trompettistes, pour les autres, “ Bird’s best bop on Verve ”. Le titre dit bien le contenu. En prime le témoignage de Phil Woods – saxophoniste alto qui a été jusqu’à épouser Chan et jouer avec l’instrument de Parker, Phil avec raison a contesté cette dernière assertion – et des notes musicographiques de Jon Shapiro, le tout malheureusement dans la langue originale de Walt Whitman.
Polygram profite de 75éme anniversaire, sur lequel il y a moins de « battage » que je ne le pensais, pour rééditer des enregistrements liés au nom de  l’Oiseau. Ainsi pour cet album « EmArcy » du batteur Max Roach, en 1957, « The Max Roach 4 plays Charlie Parker ». l’amateur ne peut que s’en féliciter. Cet album avait disparu des bacs des disquaires, comme tous les 33 tours, et c’était dommage. C’est sa première réédition en laser, avec comme cadeau 4 titres inédits. A cette époque, après la disparition dans un accident d’automobile du trompettiste Clifford Brown, avec qui il avait formé un ensemble – un traumatisme dont il mettra du temps à se remettre – il avait formé un groupe sans piano. La minutie mathématique des solos de Max Roach saute aux oreilles, comme s’il voulait par cet intermédiaire conjurer le sort, le destin pour faire croire à une harmonie abstraite. Un très bel album méconnu.
l’Oiseau. Ainsi pour cet album « EmArcy » du batteur Max Roach, en 1957, « The Max Roach 4 plays Charlie Parker ». l’amateur ne peut que s’en féliciter. Cet album avait disparu des bacs des disquaires, comme tous les 33 tours, et c’était dommage. C’est sa première réédition en laser, avec comme cadeau 4 titres inédits. A cette époque, après la disparition dans un accident d’automobile du trompettiste Clifford Brown, avec qui il avait formé un ensemble – un traumatisme dont il mettra du temps à se remettre – il avait formé un groupe sans piano. La minutie mathématique des solos de Max Roach saute aux oreilles, comme s’il voulait par cet intermédiaire conjurer le sort, le destin pour faire croire à une harmonie abstraite. Un très bel album méconnu.
1Film qui fait la part trop belle au “ junkie ” – drogué – Parker, au détriment du musicien génial. Mais le génie résiste aux images, et c’est peut-être tant mieux. Eastwood s’est appuyé sur le témoignage de Chan Richardson – la dernière Mme Parker – trop exclusivement. Elle a d’ailleurs publié son autobiographie, chez Plon, “ Ma vie en Mi bémol ”. Le Mi bémol représentant le saxophone alto.
2 Tercinet fait une étrange erreur dans les premières lignes du livret. Il appelle la pianiste de KC, Mary Lou Williams, Mary Kirk. Or, avant d’épouser à 16 ans, le saxophoniste John Williams, elle se nommait Mary Elfrieda Scruggs, un nom aux sonorités étranges, et sera la pianiste-arrangeure de l’orchestre d’Andy Kirk. Le raccourci peut s’expliquer de cette façon.
Note : un article que j’avais écrit en 1995que je republie pour le 100e anniversaire comme le titre l’indique.
